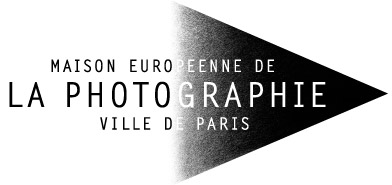Exposition NOS DESERTS // |
||
|
||
Plateforme réunit quatre photographes montrant les mécanismes de dépersonnalisation à l’œuvre dans Réalisés à Paris et Moscou, les panoramiques d’Alexeï Vassiliev de la série Quo Vaditis ? décrivent des foules Ce sont des foules que l’on logerait volontiers dans les lotissements pavillonnaires photographiés Avec les Incidents de Vincent Debanne, les édifices instaurant un contrôle républicain sur les banlieues parisiennes – hôtels de ville, préfectures – sont victimes de subtiles altérations : incendies, bris de glace, Chez François Ronsiaux, l’absence prend la forme d’une présence masquée. Dans 28ème parallèle, les figures en combinaison de latex envahissent les décors du monde globalisé - salles de meeting, hôtels d’affaires– et hantent les technocrates qui les peuplent. S’agit-il d’une vraie révolte, ou d’une simple levée de clones, blancs de toute intention ? Dans le vide qu’instaure cet absentéisme des êtres, c’est une question, tout aussi politique qu’esthétique,
Artistes : Jean-Pierre Attal, Vincent Debanne, François Ronsiaux, Alexeï Vassiliev.
|
||
Jean-Pierre Attal Intra muros. |
||
 |
||
Lorsque l’on parle de « lotissement pavillonnaire », la plupart des gens mettent immédiatement une image sur ce terme. J’ai donc eu envie de poser ma vision sur cet inconscient collectif, explorant ainsi un nouvel archétype de fourmilière. Ce travail a été réalisé aux limites extrêmes de la mégapole parisienne. Cette frontière sans cesse en évolution est colonisée par un habitat d'une absurdité inquiétante. Ces unités de vie trop bien rangées se ressemblent pour mieux se rassurer. Elles débordent de répétition et en niant toute différence, provoquent un sentiment angoissant de vide. Difficile ici de parler de centre ville, l’absence de tout commerce et de tout espace collectif donne la sensation de se perdre dans un dédale illimité. « intra muros », où comment le désir du chacun chez-soi établit un modèle urbain désincarné. |
||
Vincent Debanne Incidents. |
||
 |
||
Vous êtes assis sur le muret qui borde le parvis de l’hôtel de ville de Créteil observant alternativement le bâtiment et l’écran de l’ordinateur posé sur vos genoux. Sur l’écran, l’image semble celle d’une carte postale ou plutôt d’une publicité immobilière, la promotion de la République se donnant en spectacle. L’hôtel de ville, bien centré, est portraituré dégagé, sur fond d’espace vert, le contexte juste signalé par les arêtes vives de l’immeuble au nord du parvis ; le projet architectural de Pierre Dufau est parfaitement mis en valeur ; la hampe du drapeau souligne l’axe vertical de symétrie de la tour et de la photographie ; le drapeau flotte mollement presque au point d’intersection des diagonales, dont l’une à droite coupe à mi-hauteur la croix de Lorraine et l’autre à gauche hérisse trois hampes ; le ciel légèrement voilé est délicatement rougeoyant. Symbole architectural actuel de l’exercice du pouvoir local et des décisions plus anciennes de réaménagement de l’espace-capitale, le monument, ainsi magnifié d’une arrogance tranquille qu’aucune présence humaine ne vient contester, hormis quelques vêtements et objets laissés sur un banc, est incidemment ébranlé par les dégagements de grenades fumigènes et le départ d’un incendie, sans doute volontairement allumé sur la terrasse qui sépare les deux corps verticaux du bâtiment. Votre regard est envoûté par les jets de fumée. Vous vous souvenez de quelques manifestations place de la République ou de la Bastille, des odeurs, du bruit, des cris, et des photographies qu’en ont diffusées les médias. Vous conviez quelques icônes du printemps 1968, les images d’insurrections populaires qui ponctuaient vos manuels scolaires, la fumée, les brèches, les couleurs du drapeau, l’élan, la fougue du peuple, la rumeur qui gronde et ce cri étrange « Aux Armes ! » que répercute Jules Michelet dans son Histoire de la Révolution française. Vous vous récitez l’article 35 de la déclaration des droits de l’an I : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Vous voyez la Bastille enfumée barrant le faubourg, pas celle des manuels scolaires de Cholat, Lallemand ou des anonymes du musée Carnavalet, mais celle d’Hubert Robert, dans le clair obscur épique de nuages et de fumée des premiers jours de sa démolition, la tour d’angle massive à la morgue déchue plantée au centre du tableau, les brèches ouvertes dans son couronnement. Vous voyez aussi les manifestations plus particulières, catégorielles, celles qui font le quotidien des actualités télévisées, les jets d’objets divers contre les façades des préfectures par des paysans étranglés par le prix de leur travail, les feux de matériaux devant les usines occupées par les ouvriers licenciés, les bris de vitres d’entreprises délocalisées ou fermées sans égard aux employés. Vous figurez un monde où l’exclusion serait la forme du projet politique. Vous affichez maintenant à l’écran les hôtels de ville de Nanterre et de Bobigny, la préfecture du Val d’Oise… ; même construction des images : l’angle imposant, hermétiquement projeté en avant, des architectures, les réminiscences atténuées, réduites, l’action invisible, anonyme, euphémique. Vous pensez à L’insurrection qui vient, largement popularisée par les médias et à ce Comité invisible qui en signe la couverture, aux émeutes de 2005 et à leurs qualifications par la presse et les responsables politiques, à l’insurrection, au repassionnement de la vie de Guy Debord. Vous êtes frappés par le vide de la scène, l’anonymat de l’incident – anagramme homophone de l’incendie qui démarre –, l’invisibilité sociale et politique des acteurs, la désertion des responsables. La nouvelle série Incidents de Vincent Debanne, en focalisant quelques architectures des lieux réels et symboliques du pouvoir local, conçus par des architectes connus,(...) conduit ainsi à méditer les temporalités récentes ou plus anciennes de l’exercice des pouvoirs représentatifs, des choix, architecturaux, urbains, quotidiens, plus ou moins imposés aux populations autant que celles des résistances, des volontés de revivifier l’ordinaire plus ou moins à distance des visibilités traditionnelles de revendication. Jean-Marie Baldner |
||
François Ronsiaux 28 ème Parallèle. |
||
 |
||
Le projet 28ème parallèle est une recherche photographique et plastique sur les différentes expressions des théories du complot. |
||
Alexeï Vassiliev Quo Vaditis ? |
||
 |
||
Dans cette série Quo Vaditis ? je continue à explorer le flou mais le sujet auquel je m’attache devient plus ambitieux. Chacune des photographies a été conçue comme une fresque et fera l’objet d’un tirage grand format (2 x 9 m). Les personnages apparaîtront ainsi « grandeur nature » créant un rapport particulier entre l’œuvre et celui qui la regarde. Mon intention est de confronter le spectateur à une échelle qui est la sienne pour mieux l’impliquer. J’aimerais qu’il entende le bruit sourd et obsédant des pas, qu’il perçoive jusqu’au vertige le faix inexorable de tant de présences, qu’il se sente progressivement happé par l’œuvre et qu’il noue avec elle des liens à la fois physiques et esthétiques. |
||